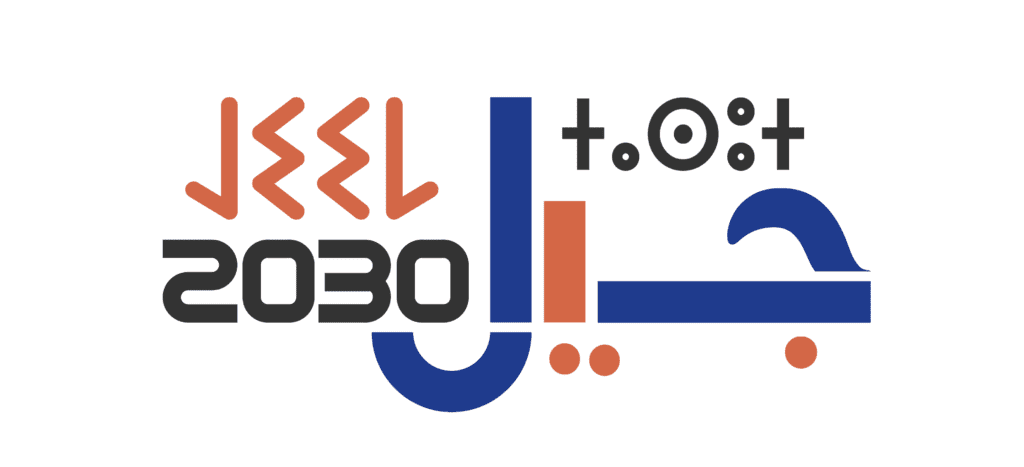Initiative Génération 2030
Cadre Fondamental –
Initiative Génération 2030 – Contexte et Fondements
L’intégration des jeunes dans la vie économique et sociale constitue un véritable défi de développement qui impacte profondément les politiques publiques élaborées par les différentes politiques sectorielles, institutions et assemblées élues. Aujourd’hui, plus que jamais, il est nécessaire d’adopter une approche globale prenant en compte l’ensemble des dimensions liées à l’insertion effective et durable de cette catégorie sociale dans la vie publique. Cela exige une mobilisation concertée de l’ensemble des acteurs et parties prenantes en vue de concevoir des stratégies intégrées et transversales, garantissant la convergence des actions et l’atteinte des objectifs escomptés.
Et bien que des avancées aient été enregistrées dans le processus d’intégration économique et sociale des jeunes au cours du mandat gouvernemental actuel, ce défi reste entravé par de nombreuses problématiques et obstacles qui empêchent une inclusion globale de cette catégorie dans la vie politique, garantissant ainsi sa participation effective à l’ensemble des aspects de la vie publique.
Selon un bulletin publié par le Haut-Commissariat au Plan le 12 juillet 2023 à l’occasion de la Journée mondiale de la jeunesse, le nombre total de jeunes âgés de 15 à 34 ans est passé de 11,5 millions en 2014 à 11,8 millions en 2023. De plus, la tranche d’âge des 15-24 ans a vu sa part évoluer de 16,1 % en 2014 à 18,0 % en 2023 au sein de cette population. Cette période a également été marquée par une hausse significative de la proportion des jeunes vivant en milieu urbain, passant de 60,0 % à 66,0%.
Dans le cadre d’une auto-saisine, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a élaboré un avis sur le thème : “Les jeunes qui ne travaillent pas, ne sont ni à l’école ni en formation (NEET)”, portant sur les jeunes âgés de 15 à 24 ans qui se trouvent en dehors du système éducatif, de formation et du marché du travail. Adopté le 30 novembre 2023, cet avis révèle qu’un jeune sur quatre dans cette tranche d’âge est en situation de NEET, soit environ 1,5 million de personnes. Selon le CESE, ce chiffre traduit les limites des politiques publiques visant l’inclusion sociale et économique des jeunes en général, et plus particulièrement de cette catégorie vulnérable. Cette vulnérabilité est souvent aggravée par une combinaison de facteurs interdépendants qui peuvent survenir à différentes étapes de la vie des jeunes, compliquant davantage le phénomène NEET. Parmi ces facteurs figurent le décrochage scolaire, la transition entre le milieu éducatif et le marché du travail, ainsi que les périodes d’inactivité entre deux emplois, dues soit à la perte d’un emploi, soit à une interruption volontaire pour rechercher de meilleures opportunités.
Ces données chiffrées, révélatrices de l’échec des politiques publiques en faveur de la jeunesse au cours des précédents mandats gouvernementaux, avaient été anticipées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, à travers ses discours et messages royaux depuis son accession au Trône de ses illustres ancêtres. Dès son premier discours du Trône, prononcé le 30 juillet 1999, le Souverain avait tracé une véritable feuille de route, incarnant le contrat social entre le Roi et le peuple. Ce discours contenait des orientations claires soulignant l’importance de garantir un enseignement de qualité et une formation adaptée, permettant aux jeunes du pays de relever les défis du XXIe siècle et d’accéder à des opportunités d’emploi dans un monde changeant.
Dans son discours aux représentants de la nation à l’occasion de la présidence de l’ouverture de la première session de la deuxième année législative de la dixième législature, Sa Majesté le Roi a réitéré que les jeunes ne bénéficient pas des manifestations et des facteurs de progrès dans notre pays. Le discours royal stipule : « Le progrès que connaît le Maroc ne s’étend malheureusement pas à tous les citoyens, notamment à notre jeunesse qui représente plus du tiers de la population et à laquelle nous consacrons toute notre attention et nos soins.
La réhabilitation de la jeunesse marocaine et son implication positive et effective dans la vie nationale est l’un des défis les plus importants à relever.
Nous avons souligné à maintes reprises, notamment dans le discours du 20 août 2012, que la jeunesse est notre véritable richesse et qu’elle doit être considérée comme un moteur de développement et non comme un obstacle à sa réalisation.
En effet, les transformations sociétales que connaît le Maroc ont abouti à l’émergence de la jeunesse en tant que nouvel acteur ayant un poids et une influence importants dans la vie nationale.
Malgré les efforts déployés, la situation de nos jeunes ne nous satisfait pas et ne les satisfait pas non plus. De nombreux jeunes souffrant d’exclusion, de chômage, d’échec dans leurs études et parfois même de difficultés d’accès aux services sociaux de base », a conclu le discours royal.
Les jeunes sont profondément concernés par les programmes et projets de développement que le gouvernement et les conseils élus sont chargés de mettre en œuvre. Cela signifie, tout d’abord, l’importance de les considérer avec respect, ensuite, d’écouter attentivement leurs idées, aspirations et visions pour le présent et l’avenir, et ce, à toutes les étapes de la préparation et de l’exécution des programmes et projets structurels et de développement. Troisièmement, il convient de les impliquer dans le processus de diagnostic et d’étude de faisabilité liés aux projets et chantiers envisagés, en tenant compte de manière précise des particularités géographiques de chaque région. Les besoins et attentes des jeunes en milieu urbain ne sont pas les mêmes que ceux des jeunes en milieu rural. Il en va de même pour les jeunes des différentes régions : par exemple, les jeunes de la région Rabat-Salé-Kénitra n’auront pas les mêmes priorités, besoins et aspirations que ceux de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, de Drâa-Tafilalet ou des régions de Laâyoune-Saguia el-Hamra.
Le Mouvement du 20 février, par exemple, en tant que l’un des mouvements sociaux les plus importants et les plus influents dans l’histoire de la lutte sociale, a constitué un jalon social important dans l’histoire politique du Maroc, car il a réussi, d’une part, à rassembler des groupes sociaux, des courants et des organismes politiques, civils et de défense des droits de l’homme idéologiquement disparates, sur la base d’un débat et de revendications sociales, politiques et de défense des droits de l’homme presque consensuels. D’autre part, le mouvement a réussi à exercer un attrait sociétal qui s’est traduit par l’adhésion populaire à ses revendications et à ses formes de protestation de la part de groupes sociaux larges et divers.
Bien que le mouvement ait réussi à communiquer ses revendications sur le terrain, à travers diverses formes de protestation, et à promouvoir ses positions sur les plateformes de médias sociaux, il a réussi, à travers ses organes de coordination et ses groupes publics, à rassembler les visions, les points de vue et les positions de nombreux acteurs politiques et des droits de l’homme de différents horizons idéologiques, ce qui reflète un grand pragmatisme dont il était armé dans l’espoir de former un front civil sur lequel les enjeux étaient importants pour réaliser une percée populaire dans la structure de l’État.
Pour sa part, l’Etat marocain a été unique dans son rapport avec le mouvement et ses revendications, comme l’a affirmé le monarque marocain dans son discours royal du 09 mars 2011 : « Je m’adresse à vous aujourd’hui au sujet de l’initiation de la prochaine phase du processus de régionalisation avancée, avec ses implications sur le développement de notre modèle démocratique et de développement distinctif, et la révision constitutionnelle profonde, que nous considérons comme un pilier des nouvelles réformes globales que nous entendons lancer en réponse permanente à toutes les composantes de la nation (…). Notre conscience profonde de l’ampleur des défis, de la légitimité des aspirations et de la nécessité de consolider les acquis et de corriger les déséquilibres n’a d’égal que notre ferme engagement à donner une forte impulsion à la dynamique de réforme profonde, dont le cœur est un système constitutionnel démocratique ». La jeunesse marocaine, qui est au centre du mouvement social, a réagi positivement, avec optimisme et espoir.
Cette dynamique sociétale, avec tout ce que l’on peut enregistrer sur les conflits idéologiques de certaines de ses composantes, a contribué de manière significative aux changements sociétaux dans la perception qu’ont les jeunes de la structure de l’État, des rôles de l’autorité exécutive et des institutions de médiation sociale, en particulier des partis politiques. Ces derniers souffraient, et souffrent encore, du silence de la voix des jeunes au sein de leurs organes et institutions.
Malgré la présence significative des jeunes dans la composition démographique, puisqu’ils constituent la base de la pyramide des âges, une simple lecture des politiques publiques destinées à la jeunesse montre l’écart important entre ce qui a été réalisé jusqu’à présent par les gouvernements précédents et les aspirations et besoins réels des jeunes dans un monde changeant, ce qui a entraîné la réaction de groupes importants de jeunes qui ont alterné entre le rejet de la réalité et la fuite dans des mondes virtuels qui sont devenus leur refuge, et ceux qui ont trouvé dans l’immigration illégale et l’extrémisme une réponse à l’incapacité de l’État de les contenir et d’absorber leurs idées et leurs attentes. C’est ce que soulignent les recommandations relatives aux politiques nationales suivies par le rapport du cinquantième anniversaire et les recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation, ainsi que l’accent mis par la Commission Spéciale sur le Modèle du Développement.
Les institutions de médiation sociale, les partis politiques en particulier, se demandent dans quelle mesure ils disposent d’un projet politique qui tienne compte de ce défi structurel dans leurs organes, étant donné qu’ils ont été le réservoir d’élites employé par l’État au cours des dernières décennies pour développer et mettre en œuvre les visions provisoires du contenu des programmes de réforme dont l’État parie sur la mise en œuvre réussie.
Si les questions relatives aux jeunes dans le cadre des politiques publiques sont de nature transversale, ce qui nécessite de leur offrir des opportunités de participer à leur formulation et à leur mise en œuvre en tant que partenaires dans la réalisation du développement global souhaité et en tant qu’acteurs au sein du système de prise de décision publique qui concerne divers domaines du développement, les partis politiques qui produisent ces politiques publiques par leur présence au gouvernement, au parlement et dans d’autres institutions et conseils constitutionnels se sont retirés de leur rôle d’encadrement de ce groupe social, puisque la représentation des jeunes dans les institutions politiques ne dépasse plus 1 %. Cette situation reflète l’incapacité des partis politiques à attirer les jeunes et à contenir leurs idées et leurs perceptions des politiques publiques destinées aux jeunes, ainsi que l’incapacité des gouvernements successifs à représenter les attentes et les besoins des jeunes et à les cristalliser dans des politiques publiques adaptées à ce groupe social, ce qui explique l’inaction des partis politiques et leur incapacité à produire de nouvelles élites qualifiées pour assumer des responsabilités organisationnelles, politiques et déléguées, leur permettant de développer et de mettre en œuvre leur vision des politiques publiques aux niveaux national, régional et local.
Le concept de participation ici va au-delà d’un simple droit, mais plutôt une culture qui s’oppose à la culture de l’indifférence, du désespoir et de l’aliénation, reflétant la volonté de donner aux citoyens et aux jeunes citoyens les moyens de contribuer à la préparation et à la mise en œuvre des politiques de développement, que ce soit par leurs propres efforts ou en partenariat et en coopération avec les secteurs et les agences du gouvernement et les autorités locales élues. Il s’agit d’un processus de partage de la gestion des affaires publiques locales et nationales par la création de mécanismes juridiques qui institutionnalisent la participation à la prise de décision à différents niveaux.
« Dignité - Espoir » - Initiative Génération 2030
Pour la Génération 2030…Que faire ?
Les jeunes représentent l’avenir de la nation et sa véritable richesse, et renforcer leur participation effective dans la vie publique est la clé pour construire une société prospère. Si les obstacles à la participation des jeunes dans la vie publique sont principalement liés à leur manque d’opportunités pour s’intégrer dans la gestion des affaires publiques, ce qui explique leur sentiment constant de marginalisation de leurs voix et opinions à chaque étape de l’élaboration des politiques publiques intégrées pour la jeunesse, il est nécessaire de favoriser des politiques publiques bénéfiques pour les jeunes et la société. Cela doit commencer par une volonté collective et une véritable inclusion des jeunes, en tenant compte de leur diversité, de leurs formations et de leurs intérêts.
Les jeunes ne constituent pas un groupe homogène, car leurs problèmes, besoins, attentes et aspirations varient considérablement. Il est donc essentiel de revoir de manière radicale les approches utilisées dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes et projets destinés à la jeunesse. Cette révision devrait permettre de placer cette catégorie au cœur du processus de diagnostic et de consultation préalable. Une telle approche offrira sans aucun doute des solutions de qualité aux problématiques des jeunes à différents niveaux.
L’État qui fait de la construction et du développement d’une stratégie nationale pour sa jeunesse l’une de ses priorités a besoin d’une vision méthodologique globale et intégrée, mettant les jeunes au cœur de ses préoccupations. Cette vision devrait les préparer à accéder à un monde fondé sur le mérite, le progrès et l’excellence. Il est crucial d’écouter attentivement les jeunes, en leur fournissant des espaces et des plateformes pour la participation et la proposition d’idées. Cela constituera la pierre angulaire pour restaurer leur confiance en eux-mêmes, d’abord, et en les institutions ainsi qu’en la pratique démocratique, ensuite. Il est ainsi nécessaire d’investir dans des programmes de sensibilisation, d’éducation et de formation spécifiquement destinés à cette tranche de la population, afin de les intégrer pleinement dans la vie publique et de renforcer leur participation politique.